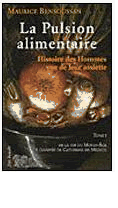Notre rôle est d'être contre-cyclique. C’est précisément quand tout le monde est d’accord qu’il faut commencer à se poser des questions.
André Schiffrin, Le Contrôle de la parole, La Fabrique.
Samedi. Je prends le temps de faire le tour des allées. C’est une impression étrange que d’être «exposant» sans être contraint de rester sur le stand. D’autant que Henri Girard, mon complice et ami, a pris son tour de garde. Je croise Untel et Unetelle : bises, poignées de mains, nouvelles, politesses. Quelque chose a-t-il changé, depuis 1980 et le premier Salon au Grand Palais, dans le spectacle annuel que choisit d’offrir l’édition ? En dehors du format du catalogue officiel, je veux dire. Oui, beaucoup. Non, très peu.
Le catalogue N°30, réalisé par ma copine Alexandra T. qui m'emmerde parce qu'elle a changé le format et qu'à côté des autres, c'est pas bien.
La multiplication d’offres numériques de tout ordre, bien sûr, au demeurant fort peu fréquentées sinon par quelques pros anxieux. La place désormais ostensible que prend la bande dessinée dans toutes ses expressions, figurines et autres gadgets franchisés compris ; et dans une mesure moindre la Fantasy, sa cousine. La présence devenue anecdotique des «petits métiers» : relieurs, calligraphes, presse à mains, ateliers de papier ont disparus, ou presque… Les institutions, qu’elles soient directement attachées au Livre ou non, ont aussi pignon sur les allées, maintenant. La télévision et la radio publiques occupent un espace disproportionné, d’autant que les émissions en direct des unes et des autres semblent se dérouler dans l’indifférence générale : Didier Porte s’époumone au Fou du roi comme si l’avenir de l’émission en dépendait et tout le monde s’en fout. La grande différence reste, encore une fois, la présence sans cesse croissante, devenue massive, des régions et de leurs cohortes d’éditeurs abrités. Que, sous ces bannières, leur soit dévolu un minuscule mètre carré ou un véritable palais avec cuisine et dépendances, c’est là indéniablement que se trouve l’armée des francs-tireurs. Il y a même cette année un vaste espace DOM-TOM qui a fait une petite place à une Haïti à genoux, ou un autre qui rassemble les pays francophones du bassin du Congo. Et bien sûr la profusion des livres, sans cesse plus envahissante, enivrante, usante, démoralisante… En trente ans, on est passé de 30 000 nouveautés par an à près de 65 000, avec une proportion plus grande encore pour les romans, à chaque rentrée littéraire. Est-ce la prolifération de ces petits éditeurs qui explique cette croissance exponentielle ? Même pas… La raison est plutôt dans ce qui n’a pas changé depuis 1980 : les grands noms.
L’absence du premier groupe français d’édition, Hachette, ne doit pas cacher que la course à la production est essentiellement due aux géants. Même les «gros» et les «moyens» ont adopté la guerre de tranchées des mammouths : occuper le mètre linéaire en librairie, et donc en chasser les autres. C’est la course au blindage et aux canons de la marine militaire européenne des débuts du xxe siècle. Chaque idée est scrutée, copiée, déclinée et rapidement mise en rayon à de meilleures conditions commerciales que celles des concurrents.
Bien sûr, certains débutants de 1980 ont grossis — Actes Sud, mais aussi Métaillié, POL, Odile Jacob… — mais les grands «équilibres» de la Guerre froide du paysage éditorial français n’ont pas changé. Quelle évolution en trente ans ? Toujours cette domination bicéphale entre Hachette et Éditis — qui depuis les égarements d’Universal a moult fois changé de nom, mais reste une hydre, même sous drapeau espagnol — et cette entente tacite entre les non-alignés, même si leur nombre a diminué. Le Seuil, conscience morale de l’échiquier, est tombé dans l’escarcelle de financiers sous l’impulsion de Hervé de la Martinière (dit HLM pour la finesse de ses aménagements). Flammarion est désormais italien, la famille ayant baissé les bras et encaissé les chèques. Restent donc Albin Michel et Gallimard. Quant à nous autres, sous-développés squelettiques, on attend quoi ? La guerre des Balkans ?
Mais il me faut retourner sur le stand, l’heure arrive des dédicaces de Claudine Candat et Henri Girard, auteurs L’Arganier. Non pas que je sois bien utile, à glandouiller en leur tenant le crachoir, mais c’est l’usage. Tiens, c’est AnicetT., ancien collègue de route.Il a quitté une boite bancale pour une autre «bankable», toujours bouffeur de bitume, toujours le même secteur. Jamais je ne pourrai me remettre le cul dans une voiture, faire six cents kilomètres pour tenter de vendre quelques exemplaires des cent trente nouveautés du mois à des libraires qui n’en peuvent mais.
La région a bien fait les choses, le stand Île-de-France est vraiment accueillant. Les auteurs en dédicace sont installés sur des tables amovibles, devant les chalands qui flânent. Claudine est toujours aussi accrocheuse, distribuant avec un sourire son argumentaire. C’est une bonne idée qu’elle a eu. C’est moins intimidant d’accepter une simple feuille, un geste qui n’engage à rien, pas comme prendre en main le livre lui-même, mais cela constitue un premier contact avec cet animal étrange assis derrière une pile et qui attend qu’on le lise comme un chien de la SPA espère qu’on l’adopte. Henri, comme à son habitude, compte sur son allure bonhomme, sa bonne bouille d’honnête homme, son œil pétillant et son humour de potache.
Aucun de nous trois n’attend vraiment quelque chose de ces séances de dédicaces. Je pourrais dire quatre en intégrant le libraire. Geneviève Brisac — écrivant dans le même Libé des écrivains Spécial Salon où Henri faisait la page des Sports — disait que cet évènement est devenu plus commercial que culturel. N’en déplaise à l’auteur de Une Année avec mon père (L’Olivier), c’est bien rare de gagner quelque argent au Salon de Paris. Les files d’attente interminables devant Anna Gavalda au Dilettante, ou Paul Auster chez Actes Sud ne doivent pas faire oublier qu’il doit y avoir entre deux et trois cents auteurs chaque jour qui vendront deux ou trois exemplaires, quand ce n’est pas zéro…
Alors, si ce n’est ni culturel ni commercial, si ce n’est ni vraiment professionnel ni très accueillant à ce public qui se sent souvent exclu des coteries affichées… À quoi sert ce salon ?
Mais nous, on s’en fout. Ce soir, c’est le rituel : on dîne À la Table marocaine, rue du Hameau , à deux pas du Hall 1. Le carré prétorien de l’Arganier, les amis, les proches. Cette année, Facebook oblige, deux nouveaux entrent dans le cercle : Magali E.et MartinD., une correctrice en or et un auteur de l’Est. On va s’en ficher plein la lampe, du tajine et du gris, et repeindre le monde des Lettres comme un éléphant : rose fluo.
Nicolas Grondin